Plusieurs maladies en cause
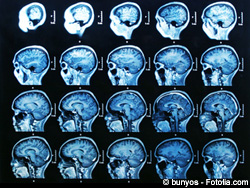 Une expertise collective de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale, France) a fait le point sur les connaissances relatives aux effets des pesticides sur la sante. Des données concernant les expositions professionnelles (dans le milieu de travail) et les expositions précoces (fœtus et jeunes enfants) ont été analysées. De plus, des éudes plus récentes ont cherché à préciser les sous-types de pathologies (par exemple, différents types de leucémies), à identifier les substances actives impliquées ou encore à investiguer le lien avec des populations supposées moins exposées que les professionnels comme les populations riveraines des zones agricoles.
Une expertise collective de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale, France) a fait le point sur les connaissances relatives aux effets des pesticides sur la sante. Des données concernant les expositions professionnelles (dans le milieu de travail) et les expositions précoces (fœtus et jeunes enfants) ont été analysées. De plus, des éudes plus récentes ont cherché à préciser les sous-types de pathologies (par exemple, différents types de leucémies), à identifier les substances actives impliquées ou encore à investiguer le lien avec des populations supposées moins exposées que les professionnels comme les populations riveraines des zones agricoles.
Les résultats de cette enquête de l’Inserm, mise à jour en 2021, dévoilent :
- Chez les professionnels, l’exposition prolongée et répétée à des doses réduites de pesticides peut entraîner une augmentation non négligeable du risque de contracter un cancer de la prostate (de 12 à 28 %). Certes, tous les pesticides concernés par ce risque sont aujourd’hui interdits (chlordécone, carbofuran, coumaphos, perméthrine…), mais l’on sait que les cancers se déclenchent souvent après une longue période de latence. De même, l’interdiction sur papier ne signifie pas forcément la fin de l’usage du produit sur le terrain.
Détail non négligeable : d’après les données de la littérature de ces trente dernières années, ce risque de cancer de la prostate concerne également les habitants des zones rurales au sens large.
Chez les professionnels exposés régulièrement aux pesticides, plusieurs études validées scientifiquement suggèrent une augmentation du risque de contracter d’autres cancers : lymphomes non-hodgkinien, myélomes multiples, voire (dans une moindre mesure) leucémies.
- Les pesticides peuvent également être à la source de maladies neurodégénératives (détruisant le système nerveux et le cerveau, particulièrement la maladie de Parkinson). En France, celle-ci a été reconnue maladie professionnelle dans le secteur agricole. Le lien entre cette maladie et l’exposition régulière aux insecticides et aux herbicides est établi, mais il ne l’est pas pour les fongicides, faute d’études suffisantes consacrées à ce sujet. Les études récentes mettent en évidence une présomption forte de lien entre l’exposition professionnelle aux pesticides et deux autres pathologies : les troubles cognitifs et la bronchopneumopathie chronique obstructive/bronchite chronique.Une présomption moyenne de lien a été également mise en évidence entre l’exposition aux pesticides, principalement chez les professionnels, et la maladie d’Alzheimer, les troubles anxio-dépressifs, certains cancers (leucémies, système nerveux central, vessie, rein, sarcomes des tissus mous), l’asthme et des pathologies thyroïdiennes.
Pour les Lymphomes non-hodgkinien, il a été possible de préciser des liens (présomption forte) avec des substances actives (malathion, diazinon, lindane, DDT) et avec une famille chimique de pesticides (organophosphorés), et pour la maladie de Parkinson et les troubles cognitifs avec les insecticides organochlorés et les organophosphorés, respectivement.
- Les femmes exposées professionnellement aux pesticides doivent être d’une prudence extrême. En effet, la littérature scientifique suggère une augmentation significative du risque de fausse-couche (mort du fœtus) et de malformation congénitale. Certaines études pointent par ailleurs, chez les enfants de ces agricultrices, une diminution de la motricité fine, de l’acuité visuelle ou de la mémoire récente.
Les études menées ces dernières années signalent également une augmentation significative du risque de leucémie et de tumeurs cérébrales chez les enfants d’agricultrices.
Certains risques de maladies, et non des moindres, concernent les femmes exposées par leurs activités professionnelles mais aussi celles qui vivent simplement au voisinage des zones agricoles. Il s’agit de malformations congénitales (cardiaques, organes sexuels, etc.).
Un nouveau lien a été mis en évidence entre le risque de leucémie aiguë lymphoblastique en cas d’exposition professionnelle paternelle en période préconceptionnelle (présomption moyenne).
Les études plus récentes, sur les pyréthrinoïdes mettent en évidence un lien entre l’exposition pendant la grossesse et l’augmentation des troubles du comportement de type internalisé tels que l’anxiété chez les enfants.
Rappelons, surtout, que la plupart de ces effets sont attribués à des molécules aujourd’hui interdites. Et que la qualité du lait maternel, en Wallonie, s’est considérablement améliorée entre 1988 et 2008 par rapport aux polluants organiques persistants (POP), dont certains pesticides.
- De plus, le lien entre certains pesticides (aujourd’hui interdits) et les troubles de la fertilité chez l’homme est établi. Il ne l’est pas, en revanche, pour les pesticides actuels. Ni en matière d’infertilité féminine.
- Enfin, les populations riveraines des zones agricoles peuvent être concernées par la dérive des produits épandus sur les cultures. Des études suggèrent un lien entre l’exposition des riverains des terres agricoles et la maladie de Parkinson, et le comportement évocateur des troubles du spectre autistique chez l’enfant.
